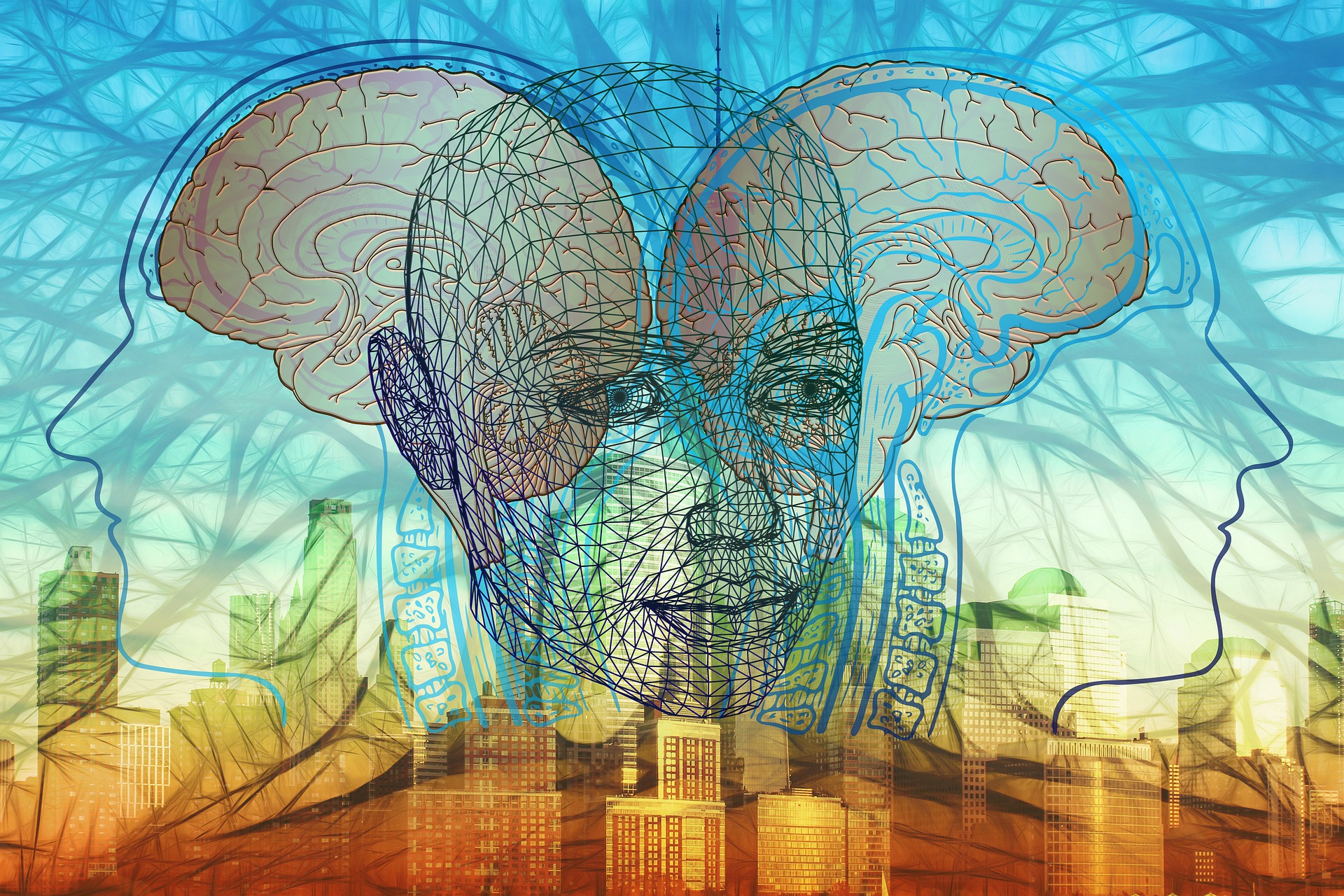Sources des images : 🔗 https://www.alderan-philo.org/activite/web-cafe-philo-lexperience-suffit-elle-pour-connaitre/ 🔗 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetradrachm_Athens_480-420BC_MBA_Lyon.jpg?uselang=fr | |
| Thème | L’expérience suffit-elle pour connaître ? |
| Animation | UPP ALDERAN |
| Date et horaires | le mardi 21 janvier 2025 de 20 h 30 à 22 h 30 |
| Mots-clés | café, débat, expérience, connaître, connaissance, expérimentation, conscience, ressenti, certitude, définitif, fiabilité, savoir, observation, représentation, réalité |
| Information | Note : pour ce web café philo en ligne, j’ai participé en contribuant également à l’animation de la parole. Pour plus de détails sur le fonctionnement de l’événement, voir la page sur le WEB café philo. |
Introduction▲
Ce WEB café philo est un café philo « en ligne », « sur le web » où les participant·es se retrouvent dans une réunion Zoom à débattre sur un sujet connu à l’avance. Il constitue le premier café philo en ligne animé par l’association UPP ALDERAN car d’autres cafés philo existent en présentiel, comme le café philo Victor Schoelcher à Toulouse.
Le sujet du débat du jour porte sur l’expérience et la connaissance. La formulation de la question du soir est la suivante :
L’expérience suffit-elle pour connaître ?
WEB Café philo, UPP ALDERAN, mardi 21 janvier 2025.
Pour répondre à ce sujet, les participant·es ont durant le débat apporté des éléments de réponse que je vais essayer de retranscrire au mieux dans cet article.
Note : cet article mentionne des éléments de réflexion du débat avec plus ou moins de précision et ne retranscrit pas l'intégralité du débat point par point. Il ne se veut donc pas exhaustif quant à son contenu mais invite à poursuivre la cogitation sur le sujet.
1. Les mots de la question du débat▲
Durant la soirée, les significations des mots expérience et connaissance ont été interrogées ainsi que l’emploi du verbe suffire.
1.1. La notion d’expérience▲
1.1.1. Définition de l’expérience selon Wikipédia▲
On peut noter d’emblée que la définition mentionnée dans l’encyclopédie Wikipédia est multifacette : elle commence par les cinq paragraphes suivants :
Wikipédia, l’encyclopédie libre, Expérience, 16/03/2025.
- L’expérience est la connaissance acquise à travers l’interaction avec l’environnement.
- Une expérience est un enchaînement d’événements dont on peut tirer une leçon par un retour d’expérience. La connaissance issue de l’expérience s’oppose à celle qui relève d’une élaboration théorique.
- L’expérience d’une personne est l’ensemble des savoirs qu’elle a acquis par la pratique, et non seulement par un enseignement formel. Lorsque cette connaissance est socialement partagée et construite dans l’intersubjectivité, il s’agit d’expérience sociale.
- En philosophie, l’expérience est un concept central du pragmatisme, par opposition aux doctrines idéalistes qui supposent une connaissance a priori.
- Une expérience scientifique est une interaction avec l’environnement destinée à vérifier une hypothèse dans le cadre d’une théorie réfutable. L’observateur définit et note précisément les conditions de réalisation afin qu’elle soit reproductible. La méthode scientifique codifie des règles d’expérimentation, l’épistémologie étudie leur validité.
1.1.2. Définition de l’expérience selon Larousse▲
La définition du Larousse est également plurielle avec sept points distincts :
Larousse, le dictionnaire français en ligne, Expérience, 16/03/2025.
- Pratique de quelque chose, de quelqu’un, épreuve de quelque chose, dont découlent un savoir, une connaissance, une habitude ; connaissance tirée de cette pratique : Conducteur sans expérience.
Synonymes : apprentissage – fréquentation – habitude – pratique – usage
Contraire : inexpérience- Fait de faire quelque chose une fois, de vivre un événement, considéré du point de vue de son aspect formateur : Avoir une expérience amoureuse.
- Action d’essayer quelque chose, de mettre à l’essai un système, une doctrine, etc. ; tentative : Tenter une expérience de vie commune.
Synonyme : tentative- Mise à l’épreuve de quelque chose, essai tenté sur quelque chose pour en vérifier les propriétés ; expérimentation : Faire l’expérience d’un médicament.
Synonymes : essai – expérimentation – test- Épreuve qui a pour objet, par l’étude d’un phénomène naturel ou provoqué, de vérifier une hypothèse ou de l’induire de cette observation : Expérience de chimie.
- Astronautique : Matériel scientifique embarqué sur un engin spatial.
- Statistique : Ensemble d’opérations à exécuter pour vérifier une probabilité.
1.1.3. Définition de l’expérience selon Wiktionnaire▲
Pareillement, la définition du Wiktionnaire se fait avec cinq points :
Wiktionnaire, le dictionnaire libre, Expérience, 16/03/2025.
- Connaissance des choses, acquise par l’usage du monde et de la vie.
- Épreuve instituée pour étudier la façon dont se passent les phénomènes naturels et rechercher les lois qui les régissent, en les reproduisant artificiellement.
- (En particulier) Essai pratiqué avec le matériel réduit d’un laboratoire dans un but scientifique ou industriel.
- (Spécialement) (Néologisme) (Anglicisme) (Souvent en apposition) Situation vécue considérée comme exceptionnelle ou marquante.
- (Philosophie) Acquisition de connaissances par l’épreuve des choses, soit au moyen des sens, soit au moyen de la conscience (par opposition à raison ou à raisonnement).
1.2. La notion de connaissance▲
1.2.1. Définition de la connaissance selon Wikipédia▲
Pour la notion de connaissance, Wikipédia mentionne explicitement la caractéristique polysémique du mot.
Wikipédia, l’encyclopédie libre, Connaissance, 16/03/2025.
- La connaissance est une notion aux sens multiples, à la fois utilisée dans le langage courant et objet d’étude poussée de la part des sciences cognitives et des philosophes contemporains.
- Les connaissances, leur nature et leur variété, la façon dont elles sont acquises, leur processus d’acquisition, leur valeur et leur rôle dans les sociétés humaines, sont étudiés par une diversité de disciplines, notamment la philosophie, la psychologie, les sciences cognitives, l’anthropologie et la sociologie.
1.2.2. Définition de la connaissance selon Larousse▲
Le dictionnaire français en ligne Larousse propose aussi une définition plurivoque :
Larousse, le dictionnaire français en ligne, Connaissance, 16/03/2025.
- Action, fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose : La connaissance de la nature.
Synonymes : appréhension – perception – représentation
Contraires : ignorance – méconnaissance- Opération par laquelle l’esprit humain procède à l’analyse d’un objet, d’une réalité et en définit la nature : Connaissance intuitive.
Synonymes : compréhension – conception – conscience – entendement – intellect – intellection – intelligence- Ensemble des domaines où s’exerce l’activité d’apprendre ; savoir : Toutes les branches de la connaissance.
Synonyme : cognition- Personne que l’on connaît, relation : Ce n’est pas vraiment un ami, c’est une simple connaissance.
Synonyme : relation
Contraire : inconnu- Capacité de quelqu’un en état d’éveil à être conscient de son existence et de la réalité qui l’entoure, état conscient ; conscience (toujours dans des expressions) : Il est tombé par terre sans connaissance.
- Religion : En style biblique, union charnelle de l’homme et de la femme.
1.2.3. Définition de la connaissance selon Wiktionnaire▲
Wiktionnaire, le dictionnaire libre, Connaissance, 16/03/2025.
- Exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets.
- Idée, notion, concept qu’on a de quelque chose, de quelqu’un ; le fait de le connaître.
- (Droit) En parlant d’un tribunal ou d’un juge, droit de traiter certaines affaires.
- Personne connue, avec laquelle on a des liaisons ou des relations.
- (Au pluriel) (Absolument) Savoir, instruction, lumières acquises.
- (Au singulier) Relation privilégiée avec les choses de la sorcellerie.
1.3. Le verbe suffire dans la question du débat▲
L’utilisation du verbe suffire n’est pas à négliger : elle pose la question de la suffisance et de la nécessité.
2. Idées et réflexions explorées durant le débat▲
Ce web café philo a donné lieu à 28 interventions des participant·es du débat du soir. Je mentionne dans ce paragraphe quelques éléments de réflexion partagés par les intervenant·es qui m’ont marquée personnellement et pour lesquels j’y trouve de la pertinence pour les rapporter dans cet ici et maintenant.
2.1. Sur le sens des mots expérience et connaissance▲
- L’expérience scientifique doit être distinguée de l’expérience personnelle.
- L’expérience est reliée à la subjectivité et la connaissance à l’objectivité. Il y a une question de nuance, d’équilibre à prendre en considération.
2.2. L’expérience comme expérimentation▲
- Une expérience peut mener à la connaissance. Un exemple d’une expérience scientifique : Galilée et la chute des corps. Aussi astucieuse que soit cette expérience de pensée, suffit-elle pour prouver que les corps chutent à la même vitesse dans le vide ?
- Une expérience peut mener à une impasse ou même conduire à l’inexactitude. Un exemple d’une expérience scientifique : Einstein et le paradoxe EPR. Une expérience du physicien français Alain Aspect invalidera cette expérience de pensée. Il recevra le prix Nobel de physique en 2022 pour ces travaux.
- Pour connaître, il faut être en mesure de pouvoir expliquer.
- Il s’agit de distinguer la collecte de connaissances, l’érudition avec l’expérience pour l’utilisation adéquate de ces connaissances. « On peut être érudit et incompétent si on utilise mal ce que l’on sait, connaît. »
2.3. L’expérience comme vécu, ressenti personnel▲
- Si l’expérience désigne la somme des apprentissages, des erreurs, des actions et projets réalisé·es par une personne, alors cette expérience peut mener à la connaissance. Mais elle peut conduire aussi à la fausseté, à l’inexactitude.
L’expérience, c’est le nom que chacun donne à ses erreurs.
Oscar Wilde, écrivain irlandais du XIXe siècle.
- L’expérience est un acte pratique. Pouvoir combiner l’expérience personnelle et la réflexion sur les informations lues via les livres.
- Une expérience sensorielle est souvent fausse à cause des limites de la perception. Exemples : évaluation de la température ambiante, illusions d’optique, biais sensoriels et cognitifs.
- Quelle réalité du monde dans lequel on évolue peut-on construire sans expériences sensorielles ? Quelle perception du monde pour les aveugles par exemple ? Le rôle du corps doit être interrogé, et pour l’expérience, et pour la connaissance.
- Pouvoir se mettre à distance pour plus d’objectivité.
2.4. Une expression parlante, signifiante▲
Un participant du débat prénommé Pascal a partagé ces mots :
L’expérience n’est pas connaissance mais sans expérience il n’y a pas de connaissance.
Pascal, participant au WEB café philo : L’expérience suffit-elle pour connaître, UPP ALDERAN, mardi 21 janvier 2025.
3. Ma réponse personnelle à la question du débat▲
A la question posée par le débat du soir :
- "L'expérience suffit-elle pour connaître ?" Je réponds :
- Non, elle ne suffit pas mais elle constitue une condition nécessaire. D'après moi, l'expérience est nécessaire sur la voie de la connaissance mais pas suffisante à cause des limites inhérentes à l'expérience. De plus, il s'agit de faire attention à la définition du mot expérience qui apporte de l'ambiguïté selon que l'on parle d'expérience au sens expérimentation ou d'expérience au sens de perception personnelle ou de ressenti, de vécu personnels.
Conclusion▲
Ce web café philo a abouti à une réponse assez consensuelle car les participant·es ont bien interrogé le sens des mots de la question posée par le débat du soir. Je relève les points suivants :
- Le mot expérience porte deux notions différentes : l’expérience personnelle et l’expérimentation dans le cadre des sciences.
- L’expérience seule ne suffit pas à produire de la connaissance mais on peut pas se passer d’expérience pour vérifier car elle apporte un constat réalistique. On doit noter l’importance de s’entendre sur l’observation, les constats des faits.
- Toute connaissance ne passe pas nécessairement par des expérimentations, notamment pour les sciences non reproductibles, par exemple les sciences du vivant, les sciences humaines comme l’histoire, l’archéologie, la sociologie, où les phénomènes étudiés sont difficilement reproductibles expérimentalement et/ou pour lesquelles le niveau de contingence des événements est élevé.
- On doit se méfier des expériences et notamment de la maîtrise du cadre dans lequel elles sont réalisées. Il peut y avoir des erreurs. Exemple cité : la génération spontanée, invalidée par Pasteur. Un gros travail de réflexions post-expérimentales doit venir compléter les résultats de l’expérience.
- L’appel à l’expérience personnelle ne constitue pas un problème et peut être pertinent lorsque cette utilisation reste dans un cadre local, personnel et que l’on ne l’étend pas dans un cadre global : « ce que je vis n’est pas ce que les autres vivent ». L’expérience personnelle ne doit pas confirmer la subjectivité.
- Les livres ne constituent pas directement les connaissances mais un moyen de les transmettre. D’où d’ailleurs la problématique de la diffusion des « fake news » ou autres informations mensongères. La production de connaissances est à distinguer de l’acquisition des connaissances déjà établies, rendue possible par la lecture et l’analyse de ce qui a été lu.
- Il n’y a pas besoin de reproduire personnellement ce qui est connu. On peut s’approprier les connaissances établies pour son compte personnel : « On est assis sur les épaules de géants sans avoir à être un géant soi-même ».